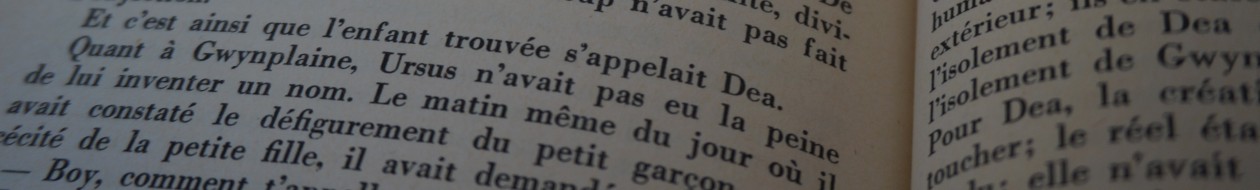Il était une fois…
Non. Pas comme ça. Ça, ça valait quand il y en avait d’autres. Pour qu’il y ait une fois, il faut qu’il y en ait d’autres. Là, il n’y a plus.
Maintenant il était une fois ça ne marche plus.
Maintenant, il n’y a plus que la Planète.
Il y avait d’autres choses , avant, des trucs, ça bougeait, ça grouillait, il y avait même tellement de ces choses qu’on utilisait des mots pour désigner leurs ensembles. Chaque chose qui vivait avait son mot, et l’ensemble de ces choses avait un autre mot, comme l’endroit où elles vivaient, encore un autre mot. Un mot pour désigner toute chose. Maintenant, il ne reste que les mots. Plus de choses. Elles ont disparus, évanouies, comme ça, comme la poussière que le choc du saut soulève lorsque mes pieds percutent le sol.
Non. En vrai, ça n’a pas pris ce temps là. En vrai, ça a pris des décennies, des siècles, peut-être même plus. Des siècles que plus rien ne bouge à part moi. D’autres siècles encore qu’ils sont partis.
J’ai envie de voir ce qu’il y a derrière la montagne, à l’est, tout au fond, juste avant l’horizon. Peut-être que j’y suis allé, avant ? Peut-être, j’ai oublié. Quand j’oublie, c’est chaque fois la première fois. Les mêmes paysages, sans doute, mais avec des yeux neufs. C’est ce que je préfère, les paysages. Surtout lorsqu’ils sont bruts, comme ça, sans rien dessus, juste purs d’eux même. J’aime moins quand il reste un petit bout de mur, quelque part, parfois c’est même plusieurs petits bouts de mur. Avant, c’était des murs tellement haut que l’on ne pouvait rien voir d’autre. Puis le temps, puis les vents, puis l’eau, quand il y en avait encore. Ça a fait des trous, des crevasses, des tas de pierres, de matière. Elle est patiente, la Planète. Tenace aussi.
Lorsque je regarde autour, j’en vois, des bouts de mur. Certains tiennent encore, hauts, très haut, avec leur œil rond comme on pouvait les faire, avant. Quand on était plein. Quand il y avait autre chose que moi. Et la Planète.
C’est qu’on lui a fait mal, à la Planète. On était tellement, puis on avait des besoins, fallait les assouvir nos besoins, tellement qu’on est allé creuser loin, très loin, jusqu’à toucher son cœur. On ne savait pas. On ne comprenait pas. On ne l’entendait pas. Enfin, certains l’entendaient. Mais elle ne parle pas toujours avec des mots, ou alors avec les siens, alors ce n’est pas facile à comprendre, ce qu’elle dit.
Je passe devant les murs très hauts avec leur œil rond. Je trace la route vers l’est sans trop les regarder. Je ne les aime pas du tout, en fait. Ils me font peur. Chaque fois que l’un d’entre eux croise ma route, avec en lui toute la prétention de ma race, j’ai peur qu’il ne s’effondre et me recouvre. Juste après qu’ils soient partis, j’ai eu besoin de ces murs. Longtemps, j’ai cru qu’ils me protégeraient. Jusqu’à réaliser leur inutilité. Que même les autres qui bougeaient, dehors, je n’avais pas à les craindre. Qu’ils ne m’en voulaient pas. Qu’Elle ne m’en voulait plus. Qu’on pouvait vivre ensemble, puisqu’ils étaient partis, puisque je n’étais plus si nombreux que ça. J’ai le souvenir qu’ils servaient à quelque chose, les yeux, en haut des murs. J’ai oublié aussi. J’ai oublié tant de chose…
Ça m’a sauté au visage quand je l’ai vu. Le portail. Il ne marchait que dans un sens. On y avait entré nos empreintes moléculaires, plus la lumière de nos cellules, tous. Il marchait comme ça, codage, déstructuration, restructuration. Je me rappelle maintenant. Les yeux. Ils servaient à se voir, même lorsqu’on était à des milliers de kilomètres les uns des autres, à se parler aussi.C’est drôle comme je me souviens de tout ça, tout à coup, alors que j’ai même oublié la couleur de la nuit. Est ce qu’il fait nuit, là où ils sont allés ? La Planète a perdu jusqu’à ses nuits. Elle n’a pas arrêté de tourner pourtant, mais il ne fait plus jamais nuit. Rien que ce ciel couleur d’ocre, partout, tout le temps, ocre comme le sol et les montagne, quand il y en a encore un peu. Le portail fait un peu d’ombre, je m’y pose. Il était très grand, quand on l’a construit. Un cercle immense, mille adultes pouvaient le passer dans le même temps sans se gêner. Il fallait bien, pour que tout le monde puisse partir. Il est devenu tout petit, lorsqu’il s’est refermé. A peine assez grand pour me faire de l’ombre. Ils avaient calculé : le passage ne pouvait se faire que dans un point sur la carte de l’espace et du temps. En dehors de ce point, rien ne pourrait y entrer, rien ne pourrait en sortir. Je me suis juste mis en dehors de ce point. Je ne suis pas passé. Je suis resté. J’ai passé trop de temps à l’ombre de ce portail, ça me rappelle des choses. Je n’aime pas me souvenir.
Je recommence à marcher, en soulevant des nuages poussière qui se déposent, en fonction des vents et de leurs directions, sur le vert des murs ou en dune un peu plus loin. Le vert, c’est l’oxydation des matériaux. J’ai appris ça sur les machines. Comment les forages ont changé la Planète, les métaux, les matières dont on faisait le murs ne réagissait plus comme on s’y attendait, comme ils avaient toujours réagi. Je crois qu’avant, ils devenaient gris. Maintenant, ils sont verts. Ça ne change pas grand-chose, au final.
J’ai perdu la montagne que je voulais rejoindre. Elle est cachée derrière les murs. Si je les contourne, je la retrouverai. J’aime bien savoir que j’ai la Planète pour moi tout seul. J’ai toujours aimé ça. Qu’il n’y ait plus, sur sa surface, qu’Elle et moi comme êtres pensants. Puis comme être tout court. Des fois, elle me demande : ils auront compris, tu crois ? Je ne répond pas. J’ai décidé de rester là. Si, je répond parfois que je ne sais pas.
Au départ, je pensais que je n’aurais pas beaucoup de temps. Alors j’ai appris. J’ai lu tout ce que je pouvais lire, sur les machines puis sur les filmécrans. On ne pouvait faire passer que du vivant, par le portail, les filmécrans et les machines, ça n’est pas tout à fait vivant. J’ai parcouru toutes les scitothèques que j’ai pu trouver. J’y ai passé le temps de plusieurs vies. Je me disais que je n’aurais pas assez de temps pour apprendre, que, sans doute, la mort me prendrait avant.
Je vois enfin la montagne. J’espère qu’elle n’est pas seulement une dune, elle me paraît bien trop haute pour n’être qu’une dune mais, après tout, même en ce qui concerne les montagnes, il n’y a plus grand-chose à prévoir . Ça m’est arrivé, quelques fois, de croire que je voyais des paysages, des vallons, des collines. Le temps que j’arrive assez près pour les savoir, tout avait disparu. Quelques rigoles de sable et de poussière qui s’écoulaient d’une dune. C’est beau, les rigoles de sable, on pourrait presque les boire. De rigoles, elles deviennent rivières, fleuves, si le sol est assez vallonné, parfois, on peut voir des mers de sable, avec leurs vagues orangées qui dansent sous les caprices du vent.
On savait depuis bien avant le portail, on n’a jamais cessé de creuser. Malgré les alertes, on allait de plus en plus loin, de plus en plus profond. Comme si Elle n’avait aucune importance. On vivait à crédit, chaque année, de plus en plus tôt dans l’année. Jusqu’à ce que Lui devoir des années entières de ressources. On n’a jamais réglé notre dette. Les miens, quand ils ont terminé de l’épuiser, ils ont juste trouvé une autre planète à tuer. Je n’ai pas voulu. J’ai voulu être celui des nôtre qui paie sa part de dette.
En fait, je sais. Comment ils ont fait, avec Elle. C’est pour ça, je ne veux pas lui répondre. Comment ils ont remplacé son champs magnétique par des machines, parce qu’il fallait forer, forer, extraire, extraire, tout ce qu’il y avait dans le sol pour construire toujours plus de machines, remplacer ce qui existait déjà, ce que la Planète avait mis des millénaires à façonner, par des bouts de ferrailles obsolètes en moins de trois cycles quand ce qu’Elle nous donnait valait pour des millénaires. Tout ça dans un seul but. Sauf qu’il ne devait pas être aussi important que ça, le but, parce lui aussi, je l’ai oublié.
Entre le reste de mur et la montagne, il y a un petit lac de sable. Je le contourne, reconnaître ses courants, ceux qui peuvent mener de l’autre coté, ceux qui pourrait m’engloutir parce que trop profonds. Je m’élance, j’en attrape un, il me porte. Je traverse le lac de sable porté comme ça, vers l’autre rive, une petite falaise de pierre, ocre sur ocre , on la distingue à peine. C’est dans un petit lac comme ça que c’était arrivé. J’avais déjà commencé à m’injecter des cybersomes. Ils servaient à nous augmenter, un mélange de machines et de matière organique, qu’on s’injectait, qui s’infiltraient jusque dans les noyaux de nos cellules. Ils devenaient un peu de nous, nous rendaient plus résistants, plus adaptables. Pour le Voyage. Parce qu’on ne savait pas trop ce qu’il y avait, au bout du Voyage. Une injection, pas plus, ils en avaient amené un stock avec eux. Pour le cas où. Le reste de stocks, je l’avais trouvé, je l’avais testé. Je courais plus vite, je sautais plus haut, je trouvais ma nourriture plus facilement. Jusqu’à ne plus avoir besoin de nourriture. Jusqu’à ne plus avoir besoin d’eau. Jusqu’à me passer de sommeil. Jusqu’à dépasser de plusieurs vies ce que j’avais espéré de temps à vivre.
Le courant me dépose au pied de la falaise, je la franchis d’un bond. Derrière moi, il y a le lac rouge, les murs verts avec leurs yeux, et au dessus, les cercles satellites qui ont remplacés le champs magnétique de la Planète. Elle est au bord de l’explosion, tout le temps, depuis tout ce temps. C’est pour ça qu’ils sont devenus brillants, de petits soleils. C’est pour ça que personnes ne voulait rester auprès d’Elle. On ne sait jamais quand Elle peut exploser, ils disaient. Plus le soleil, le vrai, que l’atmosphère chargée de poussière rend orange. Il était jaune lorsque le ciel était encore bleu. Même quand il se couche, les satellites restent, ils brûlent toujours, ils brillent sans cesse. Il n’y a plus de nuit. Un jour, l’un deux fondra complètement. Je ne sais pas quand. On partira en poussière, la Planète et moi. On mourra ensemble, de vieux amants qui s’éteignent en même temps.
J’aimerais qu’il attende un peu, que j’arrive en haut de la montagne. Le soleil commence sa course au dessus d’elle. Je ne sens plus si il réchauffe l’atmosphère. Je ne sens plus grand-chose, ni la poussière sous mes pas, ni l’air sur ma peau. Je ne sais même plus si c’est vraiment de la peau. Ni s’il reste de l’air autour. C’était beige mat avant. Avant cette chose dans le sable que je n’ai pas même pu voir. Je pensais être le dernier être vivant sur la Planète. J’ai traversé sans me méfier. Elle a jailli, un éclair, une trace sur ma jambe, le signal de la douleur, aiguë, qui remonte jusqu’à la colonne, jusqu’au crane. J’avais déjà intégré trop de cybersomes. J’ai réussi à me traîner jusqu’à en trouver d’autres, dernière injection des dernières doses. J’ai muté. J’ai fusionné avec ce qui m’a piqué. J’ai une drôle d’ombre maintenant. Une drôle de peau aussi, comme la cuirasse des scarabée qu’on emprisonnait, quand on était enfant. Un monstre en cuir qui ne dort ni ne mange, un fantôme peut-être, va savoir.
C’est une montagne. Un roc, ses parties oxydées affleurent, sous la poussière rouge, entre les rigoles de sable. Au sommet, je m’accroupis sur l’effleurement d’un rocher qui ne s’est pas encore effrité. De ma vigie, je vois le lac de sable qui se forme dans un petit vallon. Il reste d’autres montagnes, loin, très loin vers l’horizon. Sur les mers, les dunes se font, se défont sous les caprices des vents. Juste derrière le lac, une ancienne cité s’éveille d’une lumière différente, le soleil éclaire les murs, ils pourraient être d’émeraude. Tiens, je me souviens, maintenant, pourquoi on a creusé autant. Ça n’était pas si important, finalement, l’argent. J’entends, en dessous de moi, la Planète qui rit un peu de m’entendre penser ça. Au loin, dans les rayons du soleil levant, une aurore à particules s’éclaire. Que j’aime cette Planète. Celle qu’avant, avec les autres humains, nous appelions la Terre.