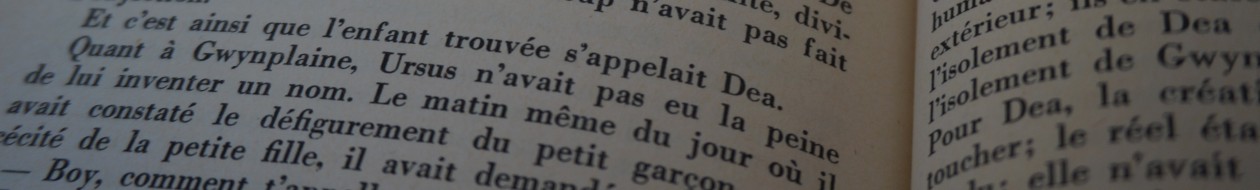Elle marche. De long en large trop vite, pas assez, devant l’immeuble, devant sa maison elle marche. Cette jupe est trop courte. Ça se voit qu’elle est trop courte, même sous le manteau . Elle pleure. Elle voudrait rentrer. Elle n’a pas envie de rentrer. Elle avance sa main, ouvrir cette porte, monter, l’autre porte, le lit, s’étendre. Continuer de pleurer. S’étendre et ne plus penser. Mais elle continuera de penser. Elle ne veut plus penser. Elle ne pousse pas la porte. Elle change de direction, elle s’éloigne, aller, partir, loin, nulle part. Elle voudrait courir même. Elle a une aiguille plantée au milieu de sa poitrine, ça va l’empêcher de dormir, alors autant courir sur les aiguilles de ses talons… Elle sait. Ça ne la laissera pas tranquille. Elle enfonce les mains dans ses poches. Le téléphone. Elle pourrait appeler. Gueuler sa rage, fumer, trop, pleurer, encore. Mais non. Franchement ça mérite pas qu’elle dérange, puis toujours les mêmes personnes, elles doivent être fatiguées d’être réveillée en pleine nuit pour… ça.
Il devait rentrer. Sauf qu’il l’a vue bondir hors de la voiture, il a vu comment elle a claqué la portière, ce qu’elle a craché sur la vitre. Elle est belle même avec les traces noires de trop de mensonges sur ses joues. Elle est belle avec ses jambes qui montent trop haut et sa démarche que les échasses font chavirer. Elle est belle avec sa rage même pas contenue. Il aimerait bien avoir le cran de lui parler, poser sa main sur son épaule, lui dire que ça n’est rien. Pas grave. On guérit à la fin, même des cons. Il reste toujours là, dans le fond, la trace, mais, par dessus, on guérit de tout. Il n’ose pas. Il y a trop de trop chez elle. Puis il n’est pas présentable. Un moment qu’il ne l’est plus. Il devrait aller ailleurs, pas regarder, sauf que s’il regarde ailleurs, ses yeux brûlent alors il y revient . Elle part, elle court presque, sur la pointe des pieds, à chaque pas, elle manque de s’effondrer. Il marche derrière elle, juste assez loin pour qu’elle ne le voit pas trop, peut être même qu’elle ne s’en apercevra pas, peut être même qu’il pourra continuer à la voir.
Une pauvre conne pauvre conne pauvre petite conne… Elle claque trop fort ses talons sur les pavés, ils ne tiendront pas, elle le sait, elle finira sans. Pieds nus. Au fond c’est tout ce qu’elle est, une va-nu-pieds. Il n’y a que dans les contes pour petites filles qui rêvent que les va-nu-pieds deviennent des princesses. Dans la vie véritable, elles finissent toujours par faire claquer leurs talons sur des trottoirs pavés, la nuit. Elle a mal partout, et le besoin d’un verre. Mais on n’est pas dans une rue pour boire, ça non, quartier résidentiel, petits supermarchés tous propres, grille fermée à cette heure, tard, il est trop tard et elle, elle marche toute seule sur un trottoir trop vide. C’est dangereux les trottoirs quand les rues sont vides. La jupe courte, c’était pour lui. Qu’il la désire. Qu’il l’aime. Qu’elle soit importante, pour lui. Elle n’a jamais aimé les jupes courtes, ça fait qu’on la regarde, tous, les hommes, les femmes, le pire, c’est les femmes, comment elles la regardent. Elle n’est pas le genre de femme à pouvoir marcher seule, la nuit. Peut-être même qu’elle pourrait en mourir. Un instant, ça la fait sourire. Non, en vrai ça lui fait peur. A mourir, puisque sur ce trottoir elle meure, que ce soit de sa main, d’aucune autre. Elle accélère. Elle se dit peut être que si elle meure elle va arrêter de penser. En vrai, elle veut seulement cesser de penser à lui. Elle arrive sur une autre rue, là, elle le sait, il y a un endroit où on peut boire. Il ferme tard. Comme un papillon de nuit va se cramer sur un néon, elle pousse la porte, descend l’escalier sombre et se penche sur le bar.
Elle commande un verre, deux, cinq, plus peut-être. Elle veut se cramer à l’alcool pour oublier les larmes qui brûlent ses yeux, que l’amertume au fond de sa gorge n’ait plus le goût de la mer. Elle tangue trop, elle chavire, elle vire ses chaussures, elle est toute petite. Une toute petite fille au fond d’une cave avec pour bouée un verre et l’amer de sa vie qui finira par la noyer. Du plus loin qu’elle se souvienne, elle n’a jamais su aimer. Aimer c’est un calcul. Un jeu. Un spectacle. Faut pas chercher à être vraie, pour aimer sans pleurer, faut dire les bons mots, ceux qui caressent et ceux qui blessent, avoir les bons gestes, savoir partir, être prête à revenir, cultiver le manque, offrir ses absences. Elle, elle n’a jamais rien eu à offrir. Alors elle donne. Tout. Forcément, ils prennent. Tout. Ils prennent, surtout lorsqu’elle ne veut pas donner. Par force. Par ruse. Par jeu. Ils ont toujours pris, consommé, épuisé, manipulé, piétiné ce qu’elle était. Ils l’ont déifié lorsqu’elle a résisté, ils l’ont réifié lorsqu’elle leur a cédé. Puis ils sont partis, avec leur trophée, en aimer une autre, un vrai être humain avec de vraies envies, une vraie vie.
Il n’aurait pas du la laisser rentrer. Il aurait fallu qu’il ose, l’arrêter, lui parler, lui dire. Lui montrer. Il les connaît, lui, les endroits qui rendent plus belle la nuit. C’est pas dans les caves que la nuit est belle, non. Faut s’approcher des étoiles, faut monter, faut s’élever. On s’élève pas, dans une cave, on prend le premier, la première qui passe et on attend avec que la douleur s’efface. Pour ne pas rester seul, pour venger son deuil. Mais ça fait rien, à part rajouter du pathétique. Il espère qu’elle sortira bientôt, qu’elle passera la porte, surtout, surtout, qu’elle sera seule.
Elle fixe le fond de son verre. Quand ils restent, c’est pire. Elle devient sous leurs doigts une poupée de cire à modeler. Ils plantent des crochets à ses articulations, ils y accrochent des fils et ils l’agitent. Ils l’exhibent comme une image qu’on projette, sans identité ni volonté, un jouet. Lorsqu’elle n’amuse plus, que ses couleurs ont fanées, qu’elle se réclame de l’humanité, ils piétinent, ils cassent, ils la relèguent dans un coin quelque temps avant de la glisser distraitement dans un benne. Du plus loin que peut porter son souvenir, elle n’a jamais aimé un homme sans souffrir. Ce soir, elle est un vieux chewing-gum qui aurait perdu son goût collé sur un tabouret de bar. En avalant un gorgée, elle manque de s’étouffer de rire.
Au fond de la salle, il y a cet homme, seul. Il se lève lorsqu’il la voit rire. Il prend son manque d’air pour une invitation, il se perche sur le tabouret, trop près du sien. Il veut tout savoir, il veut qu’elle donne, encore. Sauf qu’elle n’a plus rien, rien que sa rage muette et la douleur qui affleure sous l’alcool de ses veines. Elle secoue la tête, gentiment, vraiment, elle n’a pas envie de donner, ce soir. Pas parler non plus, désolée. Il ne comprend pas, il pourrait pourtant, il ne veut pas, vraiment . Pourquoi ? Pourquoi non, pourquoi elle est ici, si c’est pour dire non. Elle n’a pas à dire non, autrement elle ne sort pas, elle sort encore moins habillée comme ça… Quand on montre, là, tout ça, c’est bien qu’on cherche, elle cherche, elle doit forcément chercher, autrement elle ne serait pas là…
Avant, elle se serait réfugié auprès du serveur. Avant, elle aurait essayé de calmer l’homme, peut-être même, elle lui aurait parlé, elle aurait flirté, un peu. Elle aurait fait semblant d’être ce qu’il voulait. Pas ce soir. Plus maintenant. Elle tourne son verre dans sa main. Il est lourd, ce verre. L’homme ne s’arrête pas, personne ne l’arrête, il hurle maintenant qu’elle n’aurait pas du sortir si elle ne voulait pas de compagnie, surtout pas avec ces jambes là, encore moins avec ce corps là, ce visage là. Sa voix devient trop forte, plus forte que la musique, sa bouche est trop près de sa mâchoire, elle peut le sentir, en parfums, en souffle. Il n’a pas à être là. Elle veut qu’il parte. Maintenant. Ses mains s’agitent, elles se rapprochent de ses seins, de sa taille. Sur le bar, le serveur a laissé une bouteille à moitié pleine de ce qu’elle n’a pas bu. Il l’agrippe, il serre, il lui fait mal, il la dégoute. Il va bien falloir qu’il la lâche. La bouteille, le crâne, ça fait un bruit bizarre la rencontre des deux, il y a des éclats de verre sur ses épaules, sur le tabouret, on dirait un dessin, une constellation de matière brillante dans la pénombre. Un peu de liquide rouge sombre glisse le long de son nez, de ses tempes.
Elle attrape ses chaussures, elle court, ses bas s’effilent sur l’escalier, il la suivra, il voudra sa revanche, la rue, courir, courir jusqu’à l’immeuble, s’abriter… Elle pousse la porte.
Il est resté là, comme s’il avait su.
Elle a eu peur de lui, quand il l’a suivie jusque là. Elle a eu peur de son allure, de ce manteau sans âge, de ce chapeau sans forme, de sa gueule. Maintenant, elle ne voit que ses yeux. Noirs, immenses, l’océan quand il n’y a pas de lune, des yeux d’enfant dans un visage d’homme. Ils lui font oublier un instant le mal dans ses veines, le sang qui coule sur le visage de l’autre. Celui qui ne passe plus la porte, derrière elle, qui recule, il recule de cette présence, il grogne un peu mais il renonce. Les yeux noirs ne demandent rien. Ils ne veulent pas prendre. Ils embrassent ce qu’ils touchent. Il sourit un peu, elle dit juste merci, elle voudrait rentrer. Elle avance vers sa rue, il la suit encore, de loin, en silence. Arrivés devant sa porte, il ose. Il attrape les chaussures qu’elle n’a pas remis à ses pieds, en marchant à reculons, il lui dit allez, viens, on va voir le monde. Elle aimerait bien voir le monde. Alors, même si c’est fou, même si elle est folle, elle le suit, elle se laisse guider au hasard des ruelles. Ils trouvent un chemin, ils grimpent par delà les murs, en haut, tout en haut, toujours plus haut. Ils ne se disent rien, ils ne parlent pas. Lorsqu’il pense ne plus pouvoir monter, ils s’assoient. En dessous, les lumières de la ville veillent sur les stores clos. Ça grise toujours un peu de savoir l’autre qui dort. Ils restent un moment, posés sur ce toit, ils écoutent le silence.
Par dessus les toits, le noir de la nuit change, il mélange les couleurs, c’est un peu bleu, violet, ça devient ocre, orange. Pour la première fois, dans ce qui dort encore, elle vit, simplement, ce qui précède l’aurore.